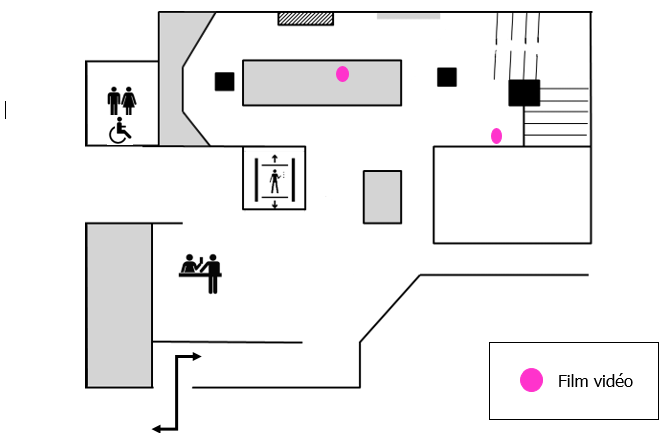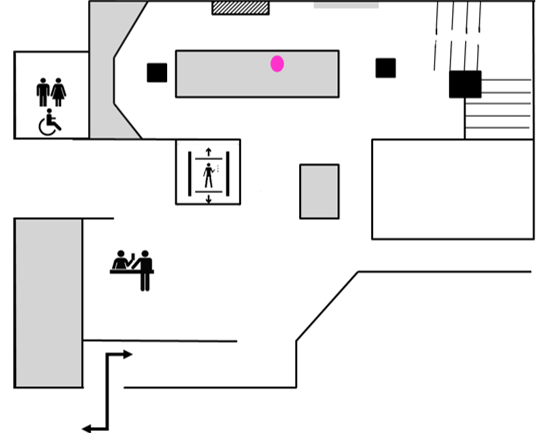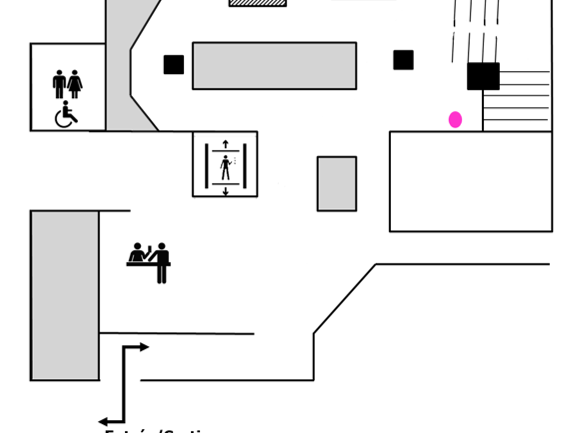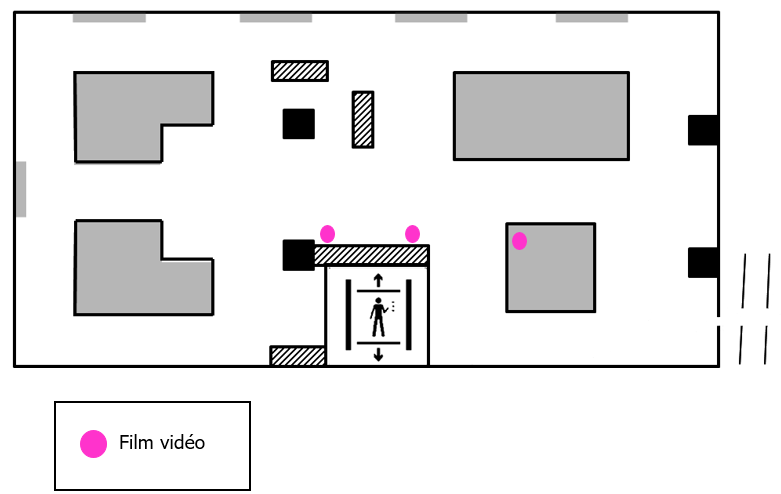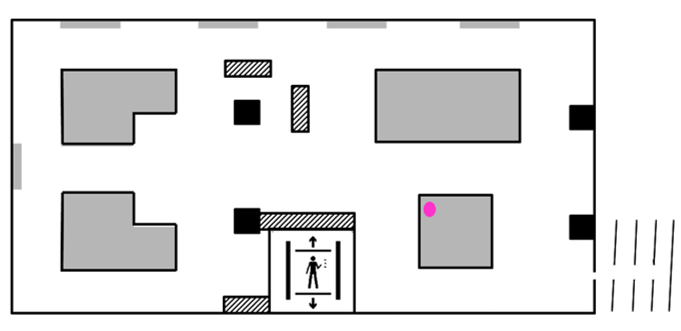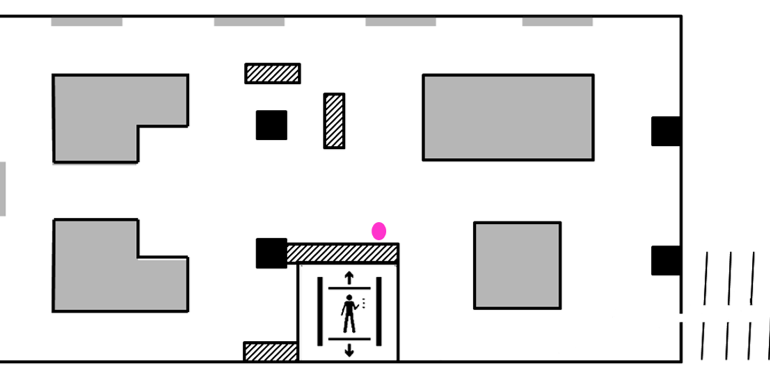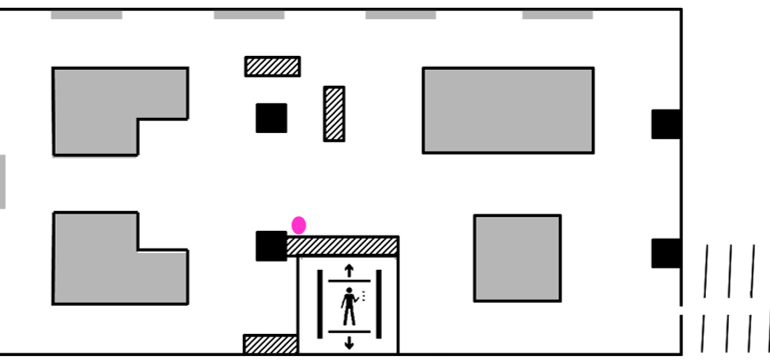Collections permanentes - rez-de-chaussée
Vitrine industrielle : la Radiotechnique (rez-de-chaussée)
1 – Témoignage d’une ouvrière de La Radiotechnique.
J’aimais bien au moment des fêtes. On s’entendait très bien entre nous.
On nous donnait des petits cadeaux : j’avais eu une paire de bas, c’était un très beau cadeau à ce moment-là.
Je travaillais sur une longue chaîne, l’une derrière l’autre, j’étais la dernière de la chaîne.
Au déjeuner, Maman me faisait un casse-croûte que j’emportais. Nous n’avions pas les moyens autrement. Papa venait de mourir.
Pour les pauses sur la chaîne, pause pipi par exemple, il fallait demander et on nous remplaçait sur la chaîne. Quand on allait à l’infirmerie aussi.
Je n’aimais pas mon travail. On m’y avait mise de force. C’était une assistante sociale qui m’avait mise là. J’ai trouvé autre chose, comme bonne chez des avocats à Neuilly, très gentils. C’était beaucoup mieux.
Chez Radiotechnique, j’avais mon samedi et mon dimanche. Comme j’étais jeune, les gens ne comprenaient pas que je n’aime pas du tout mon travail. Ma mère me disait « Tu vas t’habituer, ma fille ! »
Je n’ai jamais revu mes copines du bâtiment car Maman ne voulait pas que je sorte.
2- Témoignage d’une ouvrière de La Radiotechnique.
J’ai tous mes certificats de travail ! Ils ont déménagé au Mans, après Suresnes. J’y suis restée une dizaine d’années, j’étais aux lampes.
Je travaillais du lundi au vendredi sinon, quand il y avait trop de travail, on venait aussi le samedi. On travaillait de 8h à 19h environ. A cette époque-là, nous faisions 48 heures par semaine. Il y avait une cantine, on ne se plaignait pas.
On travaillait dans un grand atelier, il y avait sept chaînes. Il y avait un chef d’atelier qui s’appelait Monsieur Langlois. Après, il y avait un chef sur chaque chaîne. Le mien s’appelait Monsieur Armel.
J’essayais les lampes sur un tableau et, quand elles n’étaient pas bien, elles éclataient et je me sauvais ! Quand c’était les fils qui n’étaient pas bien mis, quand ça arrivait, je m’écartais. J’étais passeuse de fils. Il y avait de grosses lampes, des moyennes et même des toutes petites. On avait des blouses, il fallait pointer et il fallait qu’on soit toutes prêtes pour travailler au moment du pointage. On avait des blouses bleues marquées « Radiotechnique ». Nous n’avions pas encore de congés payés.
J’avais acheté un petit poste Radiola avec un petit œil magique dessus. Quand on le mettait en route, l’œil s’entrouvrait. Il s’ouvrait selon la distance ou le son. C’était les tous premiers.
Pour les fêtes, c’était des beaux cadeaux qu’ils nous faisaient à ce moment-là. J’ai même reçu une très belle ménagère que ma fille possède encore. Ils nous gâtaient !
3- Témoignage d’une ouvrière de La Radiotechnique.
J’avais 18-19 ans et j’y suis pas restée longtemps. Y’avait une cadence à respecter alors on trichait. Et y’avait plus de femmes que d’hommes et on s’entendait bien entre collègues. J’y ai travaillé avant 36. Y’avait pas du tout de congés à c’t’époque-là. Ça nous a laissé à toutes un bon souvenir, il y’avait une bonne entente et c’était très important. Il ne nous reste pas de photos car à c’t’époque-là on n’en faisait pas c’était très rare.
4- Témoignage d’une ouvrière de La Radiotechnique.
La Radiotechnique-Philips c’est toute ma jeunesse. Mon père y a travaillé, mes cousines. J’étais aux lampes au-début, il y avait des lampes et les radios. J’ai travaillé d’abord dans un bureau puis au standard. J’avais le petit standard au-début, il y en avait deux. Je me suis occupée du second par la suite. Mon père travaillait dans les bureaux, il s’occupait de l’organisation. Il a travaillé longtemps là-bas. Nous avions l’impression de travailler pour la modernité, les lampes, les radios, c’était les temps modernes. Nos parents n’avaient rien eux. On avait des bougies, la lampe à pétrole, la lampe-pigeon. La radio c’était un événement dans tous les foyers. Avant il n’y avait rien. C’était dans le bas de Suresnes, c’était important, une grande entreprise, il y avait beaucoup d’employés. Le directeur c’était Monsieur Damelet, c’était le grand patron. Il était gentil et juste, on l’aimait bien. Il y avait du personnel, les ingénieurs, les sous-ingénieurs, les verriers etc. Philips-Radiotechnique étaient les premiers sur le marché, ils étaient pionniers. Quand ils sont partis au Mans il a fallu trouver un autre travail sinon nous y serions restés. Nous nous y plaisions bien. A Noël, ils nous donnaient un petit cadeau, je me souviens avoir reçu une sorte d’objet décoratif, comme un compotier.
La ville en mutation (rez-de-chaussée)
De 1800 à 1900, Paris et l’Ile-de-France voient leur population multipliée par quatre. Paris représente alors la moitié de la population de l’agglomération.
A partir de 1900, la croissance de la population parisienne ralentit pour revenir aujourd’hui à son niveau de 1851 contrairement à celle de l’Ile-de-France qui continue à fortement augmenter.
Cet afflux massif de population durant le XIXe siècle provoque une véritable crise du logement.
En 1840, le docteur Villermé écrit : « Partout où la population ouvrière est en grand nombre, il ne sera jamais possible de fournir des logements convenables à tous. Les ouvriers seront toujours réduits à demeurer dans des logements incommodes, insuffisants et peu salubres. »
Le constat est terrible : l’ouvrier délaisse son foyer pour la rue et le cabaret tandis que son épouse s’étiole dans un intérieur délabré, guettée par la tuberculose. La maladie décime l’Europe, chaque année en France, c’est l’équivalent d’une ville moyenne de 100 000 habitants qui disparaît. La lutte contre la tuberculose devient une priorité.
En 1904, est mis au point le vaccin BCG. Un suivi à domicile des malades par des infirmières visiteuses se met en place et plus généralement, l’hygiène s’engage afin de réduire les épidémies et la mortalité infantile.
Les premières réponses apportées en France à la question du logement, en particulier ouvrier, sont patronales et philanthropiques. A Noisiel, en Ile-de-France, une cité est bâtie entre 1860 et 1874 pour les ouvriers du chocolatier Meunier dans une politique paternaliste. A Guise, dans le Nord de la France, le Familistère de l’entreprise Godin est construit entre 1859 et 1884. Il est un des exemples les plus aboutis de cités ouvrières, une utopie réalisée.
Parallèlement, en Angleterre en 1898, Ebenezer Howard invente le concept de Cité-jardins. À travers le diagramme dit « des trois aimants » il explique associer les avantages de la ville et de la campagne sans les désagréments des deux. La première Cité-jardins à voir le jour en Angleterre est celle de Letchworth. Ce concept est ensuite diffusé par Georges Benoit-Lévy en France.
Le constat que l’industrialisation des villes conduit à l’entassement des plus pauvres dans des quartiers sordides amène à une véritable réflexion sur l’urbanisme.
La France prend conscience de son retard vis-à-vis de ses voisins européens l’Angleterre, l’Allemagne et les pays scandinaves notamment. La question du logement se déplace alors sur le terrain politique : de nombreuses lois sont votées. Les habitations à bon marché voient le jour en 1889 grâce au financement public, d’abord local puis national. Suivent les lois Siegfried en 1894, Strauss en 1906 et Bonnevay en 1912.
A la veille de la Première Guerre mondiale, un mouvement de mal-logés s’organise autour de Georges Cochon, Président du Syndicat des locataires, qui devient un héros pour le petit peuple de Paris.
La lutte contre l’insalubrité devient une priorité de certains maires socialistes pragmatiques dont Henri Sellier est la figure majeure à partir de 1915.
Dans ce contexte, le logement social progresse en France. En Ile-de-France, il prend la forme de Cités-jardins implantées en fonction du foncier disponible mais surtout du marché du travail.
Elles proposent des logements adaptés à la taille et à la composition des familles : les parents et les enfants ont des chambres séparées, les logements ont des cuisines fonctionnelles, des toilettes et assez vite des salles d’eau, voire des salles de bain. Les conditions d’hygiène s’améliorent.
Dans le reste du territoire, se construisent de nombreux quartiers ou cités permettant aux plus modestes d’avoir des conditions de vie décentes.
Les conditions de travail et de vie s’améliorent donc progressivement. Déjà pratiqué dans de nombreuses entreprises, un jour de repos est instauré le dimanche pour les ouvriers et salariés en 1906. En 1936, la semaine de travail passe 48 heures à 40 heures et deux semaines de congés payés sont octroyées.
Henri Sellier, ministre de la santé publique au sein du gouvernement du Front populaire de Léon Blum, œuvre pour le bien de tous, notamment en encourageant les mesures d’hygiène au-delà du cadre municipal, sur le terrain national.
Collections permanentes - Premier étage
Janine Darrieux-Sellier et Henri Sellier - juin 2012 (1er étage)
Janine Darrieux-Sellier :
Papa recherchait une maison près de Bourges et depuis 1919, je vis ici où j’ai connu mes grands-parents, mes parents et les petits enfants : ça fait quatre générations.
Il a fait l’école HEC avec une bourse. C’était un jeune homme qui sortait d’un milieu qui n’était pas celui de HEC. Il s’était fait des camarades et je me rappelle il était copain de Voilin et Voilin l’a fait être Conseiller général de Puteaux et c’est en 19 qu’il a été élu Maire de Suresnes. Il a été Président du conseil général, il était Secrétaire de l’Union internationale des villes donc il était reçu partout alors on est allés en Pologne, on est allés en Russie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie : c’était surtout l’Europe centrale. Nous visitions les habitations ouvrières, les sanatoriums, les hôpitaux.
Aux HBM, les habitations à bon marché dont il était le chef, il a fait en sorte que ses architectes aient leur bureau indépendant (ils recevaient n’importe qui) mais ils avaient leur bureau ici et quand Papa avait besoin d’un architecte, il l’avait sous la main.
La première tranche de la Cité-jardins qui a dû être construite en 1921, quelque chose comme ça, c’est-à-dire qu’il y avait des salles de bains où ils mettaient des lapins, du charbon : ils ne se servaient pas des baignoires, ils sortaient de taudis !
Discours d’Henri Sellier dans la Cité-jardins de Suresnes :
« En dehors de cette cité, nous en avons construit d’autres que vous connaissez. Et dans celle-ci comme dans les autres, nous avons tenté de créer une organisation collective représentant toutes les nécessités de la vie moderne. »
Janine Darrieux-Sellier :
Alors après, la deuxième tranche, on a fait mieux. Et alors justement, les visiteuses médicales ont été créées pour ça, pour aller voir ces gens et leur donner des conseils et c’est Papa qui l’a créé ça.
Et Papa passait souvent pour voir si tout était en ordre : il y a passé souvent à l’Ecole de plein air et c’était formidable. Son ministère avait une valeur à Papa parce qu’il était toujours dans les choses sociales. Il était aussi à l’aise avec les gens fortunés qu’avec les ouvriers : aussi fraternel.
Il était très simple et il était aimé de tous, de tous de tous.
Témoignages - La cité-jardins de Suresnes (1er étage)
1-Premier témoignage : Femme qui parle
Alors, chose extraordinaire, mon père était Lorrain et ma mère Alsacienne et ils se sont connus à Asnières. Ma mère, mon grand-père, donc son père, l’a envoyée parce qu’il y avait un Allemand qui lui courait après parce qu’elle était de Berchem. Alors l’Allemand courait après ma mère et vous savez que les vrais Alsaciens n’aiment pas les Allemands. Alors ma mère a été placée à Gerardmer et comme elle était chez des Juifs, ils sont venus s’installer à Asnières. De Gerardmer ils sont venus à Asnières. Et mon père, ben pff, c’était un peu pareil. Il venait de Lorraine, il l’avait quittée pour s’en aller des Allemands. Mon frère avait 9 ans, ma sœur avait 8 ans, après maman a eu des jumeaux mais ils sont morts. Après mon frère René est né, en 20, il avait 6 ans, ma sœur en 2021, elle avait 3 ans, et mon frère est né ici, en 25. Un an après l’arrivée. On en avait trouvé un mais le propriétaire ne supportait pas les enfants et nous voilà donc presque mis à la porte et la Mairie nous a logé dans un vieux marché. A ce moment-là le patron de mon père s’était mis en relation avec monsieur Sellier, qu’il connaissait très bien. Et voilà comment nous sommes arrivés à Suresnes, au 23 avenue Jean Jaurès, en février 1924. Mon frère avait 9 ans, ma sœur avait 8 ans, après maman a eu des jumeaux mais ils sont morts. Après mon frère René est né, en 20, il avait 6 ans, ma sœur en 2021, elle avait 3 ans, et mon frère est né ici, en 25.
2-Deuxième témoignage : Femme qui parle
Pensez, c’était un rêve. Nous avions une grande salle commune, trois chambres et les waters quand même, dans la maison ! Tous les appartements autour du lavoir donc l’avenue Jean-Jaurès, l’avenue Edouard-Vaillant et l’allée des Gros Buissons où il avait des pavillons et tous les pavillons étaient pareils. C’était tout le monde pareil. Y’avait trois chambres, une grande salle commune qui faisait salle à manger-cuisine et des toilettes c’est tout. Mais y’avait le lavoir, les douches et les bains et tous les samedis c’était la grande toilette. Nous allions prendre notre bain à tour de rôle et ma mère lavait le linge tous les mercredis.
3-Troisième témoignage : Femme qui parle
J’étais à l’école dans la Cité jusqu’à 13 ans. Et puis à 13 ans je suis partie à l’école à Paris. J’étais dans une école technique, j’ai appris la lingerie. Mais il y avait des écoles pour continuer après l’école, enfin des écoles supérieures. C’était en bas de Suresnes parce qu’il y avait rien en haut. Là on va à l’école jusqu’au certificat d’études. Et puis il faut dire qui y’en a beaucoup qui ont commencé à travailler chez Coty. Mes deux sœurs ont fait comme moi, elles ont fait l’école professionnelle. Ma sœur qui était derrière moi elle a fait le corset et mon autre sœur a fait le gilet, gilet-tailleur. Tandis que mes frères sont rentrés, bien tient, justement aux Pompes Guinard, la fameuse usine. Toute la Cité-jardins bientôt travaillait aux Pompes Guinard et chez Bernard Moteur. Aaaff, on n’allait pas loin, c’était tout sur place. Sinon il fallait aller chercher le tramway. Alors l’été c’était la baladeuse ouverte et l’hiver la baladeuse fermée. Il fallait aller à ce qu’on appelle maintenant la Bérengère, c’était là qu’était le tramway qui venait de Saint-Cloud – Montretout et allait à la Porte Maillot. A l’époque c’était le seul moyen de locomotion pour aller à Paris ce fameux tramway. On pouvait aller dans le bas de Suresnes. On pouvait prendre… oh mais vous savez c’est pas comme aujourd’hui, on marchait beaucoup avant. Moi j’ai toujours beaucoup marché. Ah oui quand même il faut dire qu’il y avait aussi la gare du Val d’Or. Là c’était Saint-Cloud. Il fallait aller après la Bérengère pour prendre le train à la gare du Val d’Or, qui allait jusqu’à Paris-Saint Lazare.
4-Quatrième témoignage : Femme qui parle
J’ai demeuré deux ans à Paris mais je suis vite revenue. Il me manquait le soleil de Suresnes. C’était au 18 boulevard Aristide Briand, où je suis restée dix ans. Ensuite j’ai été à côté, parce que c’est pareil, la famille elle a grandi, alors j’ai repris à côté au 2 place Stalingrad et là je suis restée que 4 ans. Et là vu que j’avais une grande terrasse j’ai pu faire échange avec mon pavillon. Parce que le locataire du pavillon elle connaissait mon appartement, elle voulait changer parce qu’elle était veuve avec trois enfants plus sa maman et elle ne pouvait plus entretenir le pavillon. Alors il y a eu échange et ce sont les enfants qui ont poussé à la roue. Parce que ma fille et la fille de cette dame elles étaient à l’école ensemble et puis elle entendait sa mère… je ne sais pas comment c’est venu, alors elle a dit à ma fille « Dis donc, je crois que maman voudrait qu’on échange, que tes parents ils prennent le pavillon et que nous enfin… » Comme ça. Et tout d’un coup ma fille, un jour à 4h, elle vient et elle dit « Maman tu euh… papa il veut toujours qu’on déménage, qu’on ait un pavillon ? » Alors je lui dis « Oui mais tu penses comment veux-tu qu’on ait un pavillon ? » Parce que comme mon mari était taxi, il était à son compte, quand j’ai eu ma fille, ma première, alors boarf. Alors j’ai dit « Ecoute, je sais pas, alors j’irai voir la maman. ». Alors elle dit « Ah bon, elles ont parlé ? » « Oh ben pff, elle dit, oui c’était possible. » Ça a pris 6 mois pour qu’on l’ait. A chaque déménagement il y a eu des améliorations du logement. Déjà dans le premier parce qu’on avait les douches avec les waters et on avait le chauffage central. La première fois j’avais une chambre, après j’ai eu deux chambres mais j’ai eu une grande salle à manger avec une sortie sur la terrasse. Alors j’avais un enfant qui couchait-là. Parce que j’en avais quatre. Alors j’en avais un qui couchait dans la salle à manger, dans un grand divan. Et les trois autres ; mais euh c’était des grandes pièces. Maintenant j’ai trois chambres mais mes pièces étaient plus belles en appartement qu’en pavillon. Mais là il y a une salle de bain. Par contre ma mère elle a pas bougé du 23 avenue Jean Jaurès. Elle y est restée jusqu’à sa mort : 1924-1979. Mais je n’ai pas vraiment eu de chance parce que mes enfants n’ont pas pu avoir d’appartement dans la Cité. Je le regrette un peu mais enfin, le nom, quand même, continuera dans la Cité avec mes neveux et mes nièces. Mon frère Jean, sa femme elle était de la Cité. Ma sœur Marcelle, il était du même bâtiment. Ma fille aînée, il était de la Cité. Jojo, celui que j’ai perdu, elle était d’en bas de Suresnes…Non, euh, elle était de Dordogne, mais ils sont revenus. Puis il en a épousé une qui était de la Cité. Paulo, il a connu sa première femme en faisant son régiment à Montluçon. Et Guy, elle était de Rueil.
Témoignages - L'Ecole de plein air de Suresnes (1er étage)
1-Premier témoignage : Femme qui parle
Mes parents sont arrivés à Suresnes en 1932. Parce qu’on habitait à Puteaux et ma foi j’étais à l’école Edouard-Vaillant. Et en 1935 je suis rentrée à l’EPA. Avant j’avais fait un an en préventorium en Corrèze. Et là j’étais à l’Ecole de Plein Air pour raisons de santé, ainsi que mon frère aîné et mon deuxième frère qui était derrière moi. Je faisais du rachitisme.
Deuxième femme
J’ai fréquenté l’Ecole de plein air à partir de la petite maternelle en 1971. J’étais de santé assez fragile donc mes parents m’ont mis dans cette école et j’ai fréquenté cette école jusqu’au CM2. J’étais tout simplement anémiée, fragile. Mon frère aîné étant déjà dans cette école, on m’a facilité de pouvoir y aller. Mon frère aîné pour une leucémie, mon plus jeune frère était asthmatique. Quand on avait un aîné dans cette école c’était plus facile pour y rentrer.
Troisième femme
Moi je suis partie en 1983. Les trois dernières années on sentait déjà un petit changement.
Quatrième femme
Mais après ce qui s’est passé c’est qu’il est venu de plus en plus d’enfants de l’extérieur. Parce que moi quand j’étais là, attention, y’avait que Suresnes. Parce qu’on recrutait plus assez sur Suresnes. Parce que finalement des enfants ben, heureusement, y’en avait moins des enfants fatigués. Moi j’ai eu un leucémique. J’ai eu, enfin, on a eu vraiment des cas d’enfants fatigués ou malades ou des suites de tuberculose.
2-Deuxième témoignage : Femme qui parle
Maman travaillait beaucoup avec Henri Sellier sur le fonctionnement de l’école. C’est-à-dire qu’Henri Sellier avait eu un problème quand il a ouvert son école. Il voulait trouver des institutrices qui pouvaient se baigner avec les enfants. Ma mère faisait l’école en short. Elle était assez moderne dans ce sens-là. Il a eu un problème pour trouver des femmes assez modernes parce qu’il y avait des piscines, des douches. La chance qu’a eu Henri Sellier avec ma mère, d’ailleurs il a beaucoup travaillé avec elle, mes parents étaient très…naturistes, végétariens, ils se mettaient en bikini, se baignaient beaucoup. Ils étaient modernes. Donc il n’y avait pas de formation particulière justement il était gêné parce car dans cette école il fallait des institutrices modernes. D’ailleurs j’ai demandé à ma mère où elle avait rencontré Henri Sellier, car cela a été sa chance. Henri Sellier avait fait une piscine dans la Cité-jardins et on allait toute les semaines à la piscine. Et comme ma mère se mettait en bikini, elle est allée sur le plongeoir et Henri Sellier a dit « Qui est cette femme ? », « C’est une institutrice. » Henri Sellier a dit « C’est celle-là qu’il me faut. ». Il n’y avait pas de formation mais il cherchait des femmes qui étaient bien dans leur corps. Je me souviens quand ma mère prenait des douches, elle les prenait avec nous, elle se baignait avec nous et il fallait que les institutrices suivent.
Deuxième femme
L’Ecole de plein air a été inaugurée à Noël 1934 mais il y en avait en France dans d’autres endroits et juste avant la guerre on a créé le CEPA, le Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les Ecoles de Plein Air. Les stagiaires allaient passer les parties pratiques de l’examen à l’Ecole de plein air de Suresnes. Outre les instituteurs spécialisés, nous bénéficions aussi d’un professeur de dessin à temps plein. D’un professeur de gymnastique à temps plein avec un autre complément souvent et puis d’un professeur de chant. Et au fur et à mesure que le centre s’est étoffé, il a particulièrement travaillé sur l’aspect psychologique donc il y avait des psychologues du centre.
3-Troisième témoignage : Femme qui parle
C’était une pédagogie dite de plein air, c’est-à-dire qu’il fallait s’occuper d’enfants fatigables, en mauvais santé et tout de même essayer de leur faire reprendre d’une part conscience de leur vie, de leurs possibilités et de les rapapilloter avec eux-mêmes et les rapapilloter avec l’école. Donc il fallait quelque chose qui soit bien géré du point de vue du temps. Les travaux importants étaient faits le matin mais il y avait quand même une récréation comme partout. Récréation au cours de laquelle on distribuait du lait ou bien une boisson chaude pour les enfants qui ne supportaient pas le lait, il y en avait. Et puis il y avait éducation physique dans toutes les classes. D’autre part l’après-midi, enfin après le déjeuner, il y avait la sieste qui était un repos paisible. Puis après dans l’après-midi c’était surtout les activités d’expression d’éveil. Le programme n’était pas allégé régulièrement mais enfin nous faisions l’essentiel. Les enfants avaient en général une scolarité perturbée, d’ailleurs mes collègues n’auraient pas volontiers donné un premier de la classe en soin à l’Ecole de Plein Air. Alors nous avions des enfants vraiment en difficulté. Nous faisions l’essentiel du programme enrichi de pas mal de choses d’expression.
Deuxième femme :
C’était le programme normal, c’était simplement les horaires qui étaient adaptés et puis les activités quand même. Beaucoup d’activités manuelles, de jeux, de dessin, des contes. On était aussi toute la journée avec les enfants puisque les repas se passaient à l’école. L’avantage aussi quand même c’est qu’on était beaucoup dehors parce que ne serait-ce que pour passer d’une classe à l’autre et puis la récréation, ça c’était… Surveillant d’une récréation. Comme on était ensemble finalement, alors on surveillait la récréation. C’est vrai on était beaucoup dehors, c’était agréable pour ça.
Troisième femme :
Moi j’avais l’impression que c’était pas quelque chose de scolaire où on avait vraiment le programme avec des leçons rigides comme au collège. J’ai l’impression qu’on apprenait à apprendre et qu’on n’apprenait pas bêtement. C’est-à-dire que c’était plus dans la manière de faire les choses et d’apprendre que de faire de l’ingurgitage, du gavage en fait. Y’avait une ouverture dans la manière d’apprendre les choses qui fait que peut-être l’Histoire je savais pas par cœur certains éléments mais que par contre en Sciences j’avais peut-être une approche plus de réfléchir, de comprendre que d’apprendre par cœur. Donc c’est vrai qu’au collège ensuite ça a été difficile parce que c’est vrai qu’à certains moments j’avais l’impression d’avoir des lacunes, peut-être en « connaissances » parce que c’était pas les mêmes types de connaissance. C’est de la connaissance scolaire, c’est pas la connaissance dans la manière d’apprendre. Mais bon. Donc ça a été un peu dur et un peu inintéressant, ce qui fait que j’ai fini par redoubler ma quatrième parce que je m’essoufflais quoi et puis en plus j’étais très jeune. Et puis y’avait une ouverture, une écoute de l’enfant qui était intéressante. La raison pour laquelle j’suis arrivée à dix ans et demi au collège c’est que j’ai fait deux classes de la même année. Quand je suis arrivée en CE1, euh je sais pas, je devais pas m’enquiquiner enfin ou m’enquiquiner un peu mais, j’ai fait CP et CE1 la même année. Quand ils ont vu que je faisais pas trop l’andouille au fond de la classe et ben ils m’ont fait sauter de classe. Fin pas sauter de classe, passer dans la deuxième classe en cours d’année pour justement éviter de sauter une classe. Et donc j’ai fait CP-CE1 la première année et CE2 la deuxième année. Mais je trouvais que c’était pas mal parce que ça permettait justement de s’adapter à l’évolution des enfants sans forcément sauter une classe. C’était pas forcément une bonne chose de sauter une classe. Le collège pour moi ça avait un côté un peu militaire qui m’a un peu… on n’avait pas du tout ce fonctionnement-là. Même les heures de colle, les punitions, fallait se mettre en rang, enfin tout le côté discipline aussi. Euh nous finalement on n’était pas habitué à ce genre de chose parce que l’éducation qu’on avait c’était finalement d’apprendre à être indépendant, à se gérer je veux dire euh sans que ce soit forcément euh je veux dire. Y’avait pas de discipline mais… C’est pas qu’il y en avait pas, c’était pas la même approche. Et c’est vrai qu’on était beaucoup plus nombreux dans les classes mais bon c’était tout un autre contexte. On avait beaucoup plus de liberté, de créativité, d’initiative.
Quatrième femme :
Quand on est allé au collège on était perdu. Pour moi c’était une bonne école. J’suis allée au collège avec mon frère. On était dans la même classe puisque mon frère a 18 mois de différence avec moi. On était complètement perdu. On a eu des maux de ventre, on vomissait. Le médecin a eu ce qu’on appelle le mal de l’air. A l’Ecole de Plein Air on était un peu chouchouté. Les maîtres et maîtresses prenaient beaucoup de temps avec nous. L’épreuve c’est que quand on est allé au collège c’était complètement différent. Plusieurs professeurs. A l’Ecole de Plein Air on était dans un petit cocon, on était plus aidé. Le maître, la maîtresse passait plus de temps avec nous. On a eu beaucoup de mal.
Cinquième femme :
Ça a été mixte immédiatement. On ne pouvait pas faire à l’époque un plan d’école mixte, bon surtout pour douze classes. Alors on a fait école de garçons et école de filles. Il y avait d’ailleurs un local pour le directeur et un local pour la directrice.
Sixième femme :
On était mélangé tout de suite, c’était plus sympathique et plus moderne. Les cours de récréation c’était filles et garçons. Peut-être qu’au-départ les architectes ont pensé faire une école fille et une école garçon et qu’une fois l’école ouverte c’était mélangé. C’était mixte, dès le départ.
Septième femme :
On était toujours mélangé. Ce qui m’a bien changé quand je suis arrivée au collège, parce que c’était un collège de filles *rires*.